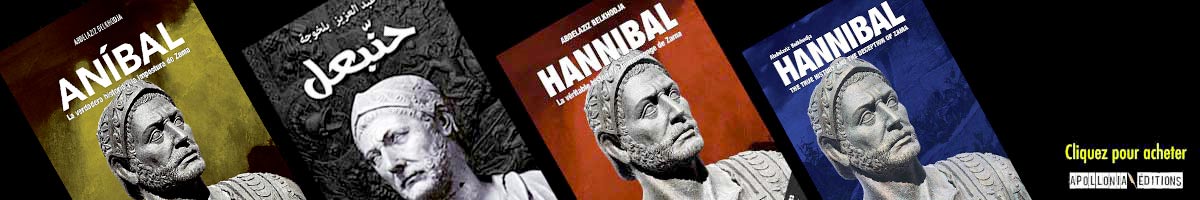Des analyses ADN dévoilent une Carthage cosmopolite et métissée, ces analyses redessinent l’histoire d’une des plus grandes civilisations de l’Antiquité. Les Carthaginois n’étaient pas les descendants directs des Phéniciens du Levant, mais un peuple divers, uni par une culture phénicienne puissante et adaptable. Siciliens, Nord-Africains, Égéens : tous ont contribué à faire de Carthage une métropole unique, un phare de la Méditerranée antique.
Carthage, la légendaire cité fondée par Elyssa/Didon selon l’histoire et la mythologie, a longtemps été vue comme une extension directe des Phéniciens du Levant, ces navigateurs et commerçants hors pair originaires de Tyr et Sidon (actuel Liban). Mais deux études génétiques, l’une publiée en 2016 et l’autre en 2025, viennent bouleverser cette image classique. Grâce à l’analyse d’ADN ancien, ces travaux révèlent que les Carthaginois étaient bien plus que des colons levantins : ils formaient un creuset de cultures et de peuples, un véritable carrefour génétique et culturel de la Méditerranée antique. Voici ce que ces découvertes nous apprennent.
2016 : Les premiers indices d’une Carthage inattendue
En 2016, une équipe internationale, incluant des chercheurs de l’Université d’Otago (Nouvelle-Zélande), de l’Université de Tunis, et d’autres institutions, publie une étude dans PLOS ONE (DOI: 10.1371/journal.pone.0155046), relayée par Phys.org. Leur sujet ? L’ADN mitochondrial d’un seul individu, surnommé le “Jeune homme de Byrsa”, découvert dans une tombe carthaginoise datant du VIe siècle av. J.-C. à Carthage. Cet homme, âgé d’environ 20 ans au moment de sa mort, était inhumé selon les rites phéniciens, dans une nécropole prestigieuse dans l’enceinte du musée archéologique de Carthage.
Le résultat est surprenant : son ADN mitochondrial, qui retrace la lignée maternelle, appartient à l’haplogroupe U5b2c1, une signature génétique rare associée aux populations européennes, probablement d’origine ibérique. Autrement dit, la mère ou la grand-mère de cet homme n’était pas une Phénicienne du Levant, mais une femme issue d’une population locale ou d’une région sous influence européenne, comme l’Espagne ou la Sardaigne. Cette découverte, bien que limitée à un seul individu, est un premier coup de tonnerre : elle suggère que les Carthaginois n’étaient pas un simple prolongement génétique des Phéniciens, mais un peuple déjà métissé, intégrant des influences locales ou méditerranéennes plus larges.
L’étude de 2016, bien que modeste en échelle, ouvre la voie à une question cruciale : qui étaient vraiment les Carthaginois ? Étaient-ils des colons levantins pure souche, ou le produit d’un mélange plus complexe ? À l’époque, les chercheurs, comme Lisa Matisoo-Smith, spéculent que les Phéniciens, en s’installant à Carthage, ont interagi et se sont mélangés avec des populations locales, peut-être nord-africaines ou européennes. Mais sans plus d’échantillons, ces hypothèses restent fragiles.
2025 : Une révolution génétique à grande échelle
Neuf ans plus tard, une étude d’une ampleur sans précédent vient confirmer et amplifier ces intuitions. Publiée en 2025 dans Nature (DOI: 10.1038/s41586-025-08913-3) par le Centre de recherche Max Planck-Harvard pour l’archéoscience de la Méditerranée antique (MHAAM), cette recherche analyse l’ADN de 210 individus inhumés dans 14 sites phéniciens et puniques à travers la Méditerranée – de la Tunisie (Carthage, Kerkouane) à Ibiza (Puig des Molins), en passant par la Sicile, la Sardaigne et l’Espagne. Dirigée par Harald Ringbauer, David Reich et Johannes Krause, avec des contributions de chercheurs comme Pierre Zalloua, cette étude, relayée par le New York Times et Haaretz, redessine complètement le portrait génétique des Carthaginois.
Les conclusions sont stupéfiantes :
-
Une ascendance phénicienne quasi absente : Contrairement à ce que les récits historiques, comme ceux d’Hérodote ou la légende de Didon, laissaient supposer, les Carthaginois avaient très peu d’ascendance génétique levantine. Les Phéniciens du Levant, fondateurs présumés de Carthage, n’ont pas envoyé de grandes vagues de colons. Leur empreinte génétique est marginale.
-
Un mélange cosmopolite : Les Carthaginois étaient un patchwork génétique. Leur ascendance dominante venait :
-
Des populations siciliennes et égéennes, proches des anciens Grecs, probablement issues des interactions en Sicile, où colonies phéniciennes et grecques coexistaient.
-
Des populations nord-africaines locales (ancêtres des Berbères), dont la contribution augmente après 500 av. J.-C., coïncidant avec l’essor politique et économique de Carthage.
-
Dans une moindre mesure, des influences ibériques et sardes, reflétant les vastes réseaux commerciaux phéniciens.
-
-
Une culture phénicienne sans racines génétiques : Malgré leur diversité génétique, les Carthaginois adoptaient pleinement l’identité phénicienne – langue punique, culte de Baal et Tanit, alphabet sémitique, pratiques commerciales. Comme le formule David Reich dans le New York Times, Carthage fonctionnait comme une “franchise culturelle” : une identité phénicienne forte, portée par des peuples d’origines biologiques variées. Pierre Zalloua, généticien à l’Université Khalifa d’Abou Dhabi, ajoute que les Phéniciens étaient des “intégrateurs”, assimilant les populations locales tout en diffusant leur culture.
-
Carthage, pionnière du cosmopolitisme : ces conclusions font de Carthage la “première civilisation biologiquement cosmopolite”. Les nécropoles puniques révèlent une société où Siciliens, Nord-Africains, Égéens et autres se côtoyaient, se mariaient, et partageaient une identité commune, un phénomène rare dans l’Antiquité.
Relier les deux études : une histoire cohérente
Les études de 2016 et 2025, bien que différentes en échelle, racontent une histoire convergente. Le “Jeune homme de Byrsa”, découvert en 1994 et dont l’analyse génétique de 2016 révèle une ascendance maternelle européenne, était un indice précoce de la diversité génétique carthaginoise. L’étude de 2025, avec ses 210 génomes, confirme cette intuition à une échelle bien plus vaste, montrant que cette diversité n’était pas une exception, mais la norme. Les deux travaux soulignent que Carthage n’était pas une colonie levantine homogène, mais un melting-pot méditerranéen, où la culture phénicienne servait de liant pour des peuples d’horizons variés.
Une différence notable réside dans la portée des conclusions. En 2016, l’analyse d’un seul individu limitait les généralisations, et les chercheurs restaient prudents, évoquant des “interactions” avec des populations locales. En 2025, grâce à une méthodologie plus robuste (séquençage de génomes entiers, large couverture géographique), l’équipe du MHAAM peut affirmer que la faible ascendance levantine et le cosmopolitisme biologique étaient des traits fondamentaux de la société punique, particulièrement à Carthage.
Pourquoi ces découvertes fascinent-elles ?
Ces révélations, surtout celles de 2025, ont fait les gros titres pour plusieurs raisons :
-
Un mythe revisité : L’image romantique de Carthage comme une colonie phénicienne pure, fondée par Elyssa/Didon et peuplée de Levantins, s’effondre. À la place, on découvre une société métissée, qui préfigure les métropoles multiculturelles modernes.
-
Une leçon sur la culture : L’étude de 2025 montre que l’identité culturelle peut transcender les origines génétiques. Les Carthaginois, bien que peu liés biologiquement au Levant, parlaient punique, vénéraient des divinités cananéennes, et dominaient le commerce méditerranéen. Comme le note Harald Ringbauer, généticien des populations, “la culture phénicienne était-elle une franchise adoptée par d’autres ?”
-
Un contraste avec les Grecs : Contrairement aux colons grecs, qui maintenaient une ascendance égéenne distincte en Sicile ou ailleurs, les Phéniciens favorisaient l’intégration. Cette stratégie explique leur succès, mais aussi leur “invisibilité” génétique dans les populations modernes.
-
Une prouesse scientifique : Extraire et analyser l’ADN ancien dans des climats chauds, comme ceux de la Tunisie ou d’Ibiza, est un exploit. Les techniques avancées utilisées en 2025, combinées à une collaboration interdisciplinaire (archéologie, génétique, histoire), ont permis de surmonter ces défis.
Ce que cela change pour l’histoire de Carthage
Ces études redéfinissent notre compréhension de Carthage et, plus largement, de la colonisation phénicienne. Elles suggèrent que les Phéniciens n’ont pas conquis par des migrations massives, mais par une influence culturelle et commerciale irrésistible. Leur alphabet, leur langue, leurs pratiques religieuses se sont propagés à travers la Méditerranée, adoptés par des populations locales qui, à leur tour, ont façonné des sociétés comme Carthage. Cette dernière, loin d’être une simple colonie, était une métropole vibrante, un carrefour où Siciliens, Nord-Africains, Égéens et autres forgeaient une identité commune.
Les découvertes posent aussi de nouvelles questions : pourquoi les populations locales ont-elles embrassé la culture phénicienne ? Était-ce lié au prestige des Phéniciens, à leurs réseaux commerciaux, ou à une forme d’acculturation volontaire ? Et où sont passés les descendants génétiques des Phéniciens ? L’étude de 2025 note que leur faible empreinte levantine pourrait refléter une élite peu nombreuse, noyée dans une population locale plus large, ou des migrations limitées dès le départ.
Conclusion : Carthage, une mosaïque méditerranéenne
Des modestes indices de 2016, avec l’ADN européen du “Jeune homme de Byrsa”, aux révélations spectaculaires de 2025, qui dévoilent une Carthage cosmopolite et métissée, ces études redessinent l’histoire d’une des plus grandes civilisations de l’Antiquité. Les Carthaginois n’étaient pas les descendants directs des Phéniciens du Levant, mais un peuple divers, uni par une culture phénicienne puissante et adaptable. Siciliens, Nord-Africains, Égéens : tous ont contribué à faire de Carthage une métropole unique, un phare de la Méditerranée antique.
Ces découvertes, en plus d’être une prouesse scientifique, nous invitent à repenser la manière dont les civilisations se forment. Carthage nous rappelle que l’identité peut transcender la biologie, et que les grandes histoires humaines naissent souvent des rencontres, des mélanges, et des échanges.
Pour aller plus loin :
-
L’étude de 2016 : L’article complet dans PLOS ONE (DOI: 10.1371/journal.pone.0155046) détaille l’analyse du “Young Man of Byrsa” et les implications pour les interactions phéniciennes.
-
L’étude de 2025 : La publication dans Nature (DOI: 10.1038/s41586-025-08913-3) est la référence pour les données génétiques et les interprétations. Le site du MHAAM (www.archaeoscience.org) ou du Max Planck Institute (www.shh.mpg.de) peut offrir des résumés accessibles.
-
Contact direct : Pour des informations non publiées ou des rapports internes, contacter : Harald Ringbauer (ringbauer@eva.mpg.de) ou Johannes Krause (krause@shh.mpg.de) pour l’étude de 2025.