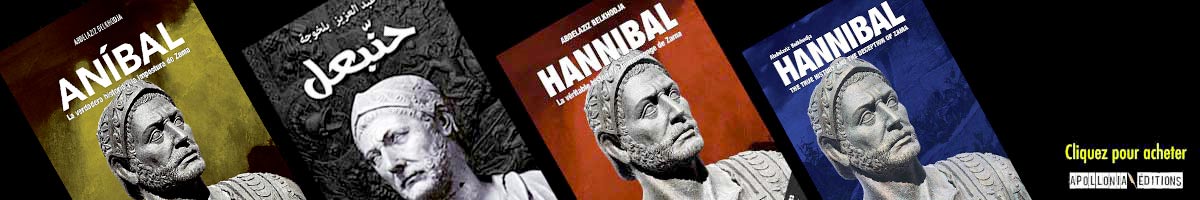Le président tunisien, M. Béji Caïd Essebsi, doit son élection à l’union des progressistes derrière sa personne, symbole d’un État fort contre le délitement de l’État provoqué par les islamistes d’Ennahdha. Son accession à la magistrature suprême a été facilitée par la présence au second tour des présidentielles en 2014 de M. Moncef Marzouki, qu’une majorité de Tunisiens ne voulait pas voir rempiler.
En mai 2017, après une période sensiblement équivalente au mandat de son prédécesseur, Béji Caïd Essebsi dispose-t-il d’un bilan plus reluisant ?
L’État est toujours fragile, l’administration est figée, les usines ferment, le chômage caracole, le dinar est au plus bas et la corruption a atteint, en se démocratisant, un niveau faramineux. Le parti vainqueur des législatives, Nidaa tounes, qui avait réussi a rassembler, non seulement la majorité des suffrages, mais aussi l’essentiel des progressistes, a été disloqué à cause de sa prise de contrôle illégale et illégitime par le propre fils du chef de l’État. Ce qui reste de ce parti est devenu l’anti-chambre d’Ennahdha qui le manipule à souhait. L’union des progressistes a explosé, les partis poussent comme des champignons, vénéneux puisque personne n’en veut. Bref, tout est à refaire pour les progressistes. Quant à la situation sécuritaire, outre les efforts fournis depuis 4 ans par les forces de l’ordre qui ont gagné en organisation, en effectifs et en matériel, elle profite aussi d’un cessez le feu des terroristes qui, de retour des zones de combat, n’ont aucun intérêt à faire des attentats qui provoqueraient une fermeture des frontières et empêcheraient leur congénères de revenir au bercail. D’ailleurs des centaines d’entre eux, revenus de Syrie et d’Irak, jouissent d’une liberté totale, ce qui devrait pousser les responsables à plus de mesures lorsqu’ils évoquent une réussite sécuritaire.
Dans l’actualité immédiate, notons la démission de M. Chafik Sarsar, chef de l’Instance électorale (ISIE), les propos malvenus de M. Riadh Mouakher et l’aveu d’impuissance du chef du gouvernement qui, avant de céder aux désidératas de la centrale syndicale en limogeant Néji Jalloul, a échoué à dénouer la révolte larvée, au sud, qui commence à faire tâche d’huile, portée par des revendications mettant en danger l’intégrité du pays.
C’est dans ces conditions particulièrement défavorables que le président Béji Caïd Essebsi a prononcé son discours. Dans la forme, le somptuaire était là. Le Palais des Congrès, qui peut recevoir jusqu’à 1500 personnes, était plein. Plusieurs mètres séparaient le président de ses auditeurs, pratique initiée par les conseillers de Ben Ali pour dissimuler son introversion et sa timidité. Pourtant, Béji Caïd Essebsi, un improvisateur de génie qui excelle dans la proximité, a été logé à la même enseigne.

M. Béji Caïd Essebsi commence son discours par un malheureux lapsus sur un verset coranique suivi d’une longue et fastidieuse introduction sur l’histoire contemporaine. Puis il parle de son fameux projet de « loi de réconciliation ». Il persiste à dire que la sortie de crise est conditionnée à l’adoption de cette loi. Des juristes de renom rejettent ces arguments et déclarent que certaines de ses dispositions sont des pirouettes juridiques destinées à assurer une impunité non due à des barons de la corruption. Qu’importe, le président insiste : pour faire passer cette loi, il faut passer par l’Assemblée. C’est le lot de toutes les lois, tout le monde le sait, mais le président insiste. Pourquoi insiste-t-il ? Si sa loi est votée, elle obtiendra toute la légalité et la légitimité nécessaires à son application, alors pourquoi cette insistance sur une évidence ?
Parce que le président sait que non seulement l’Exécutif, qu’il chapeaute, mais aussi le Législatif, ont perdu toute crédibilité et qu’une partie de la société civile peut, en s’opposant à cette loi, même votée, provoquer un contre coup politique majeur. Ce qui signifie que le régime politique actuel est si faible que même lorsqu’il fonctionne dans le respect total des règles, il est parfaitement inefficace. En clair, le système politique actuel est caduc.
Il existe, certes, des solutions pour corriger – sans réformer la Constitution – des institutions en panne : une simple réforme de la loi électorale dans le sens d’un scrutin majoritaire donnant au vainqueur la latitude nécessaire pour gouverner, pourrait sortir le pays du piège dans lequel il est empêtré.
Mais rien n’est fait en ce sens. Comme si cette situation fragile, cette situation de non droit, était préférable à un assainissement de la vie politique du pays.
Le président a aussi longuement évoqué son sujet favori, le prestige de l’État. Sujet certes séduisant, mais purement formel puisque ce prestige est tributaire du respect du sens de l’État, or, ce qui se passe actuellement en est est la parfaite antithèse. L’impunité est devenue la règle, l’inefficacité un principe. La corruption elle-même est décriée au plus haut niveau de l’État alors qu’elle est générée en son sein.
Parler de prestige de l’État dans ces conditions est à la limite du risible.
Pour tenter d’en finir avec une situation inextricable, Béji Caïd Essebsi a décidé de mobiliser l’armée pour sécuriser les sites de production mis à mal par les blocages illégaux. Bonne décision certes, mais l’État a déjà eu recours à cette procédure, sans succès. On se souvient même qu’à Kerkennah, il y a moins de 2 mois, l’Armée a été plus d’une fois empêchée de se déployer pour sécuriser le site de Petrofac.
En fait, aucune mesure n’a été décidée. Il s’agit, une nouvelle fois, d’une manœuvre médiatique, sans plus, d’une opération certainement préparée par ces fameux « conseillers en communication » passés directement des agences publicitaires aux cabinets ministériels et présidentiels et qui ignorent que pour communiquer en politique, il faut avant tout une culture politique, une vision, des plans, des idées et enfin une procédure d’action. Sinon, cela donne le lamentable spectacle auquel assistent les Tunisiens depuis 6 ans, depuis que la folie des grandeurs s’est emparée des petits.
En définitive, ce que nous révèle le discours du président, c’est l’absence de l’État dans toutes ses composantes : le Législatif ne légifère pas ou alors il légifère pour rien puisque l’Exécutif n’exécute pas. Quant à la troisième composante, le Judiciaire, libéré par la Constitution de 2014, il fait comme bon lui semble dans l’impunité la plus totale.
Mais il y a un autre pouvoir qu’on oublie généralement de mentionner, c’est celui du peuple qui, lorsqu’un régime atteint ses limites, dépasse les siennes. Nous y sommes en plein, l’anarchie se développe comme jamais. Or, nul ne voit la sortie du tunnel.
Les décideurs doivent prendre sérieusement la mesure de ce qui se passe et décider de corriger les dysfonctionnements structurels en modifiant un système électoral proportionnel inadapté à la Tunisie et qui a rendu l’État inopérant.
Le pire est que ces défauts de gouvernance vont bientôt être transposés aux municipalités et aux régions, puisqu’elles vont être soumises au même système électoral. Ainsi, dans les mois à venir, ce n’est pas seulement l’État qui sera inopérant, mais aussi les villes et les régions qui subiront des Conseils municipaux et régionaux aussi éclatés que l’Assemblée actuelle. Ils seront aussi inaptes à gérer leurs circonscriptions, que le gouvernement actuel à gérer l’État.